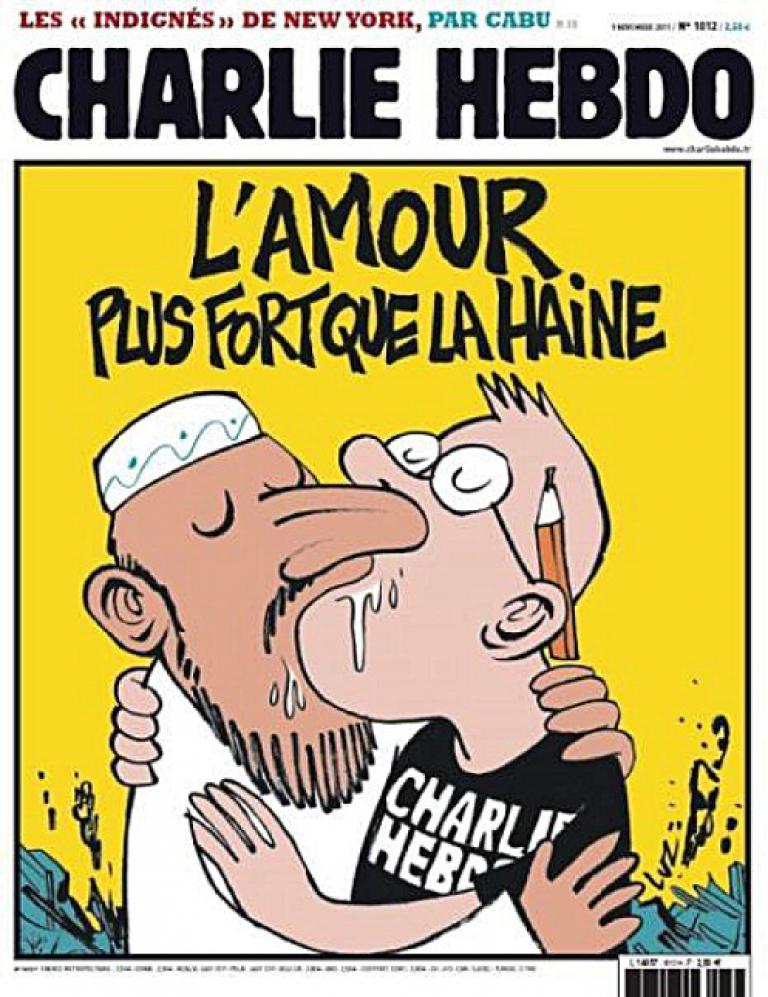Peut-on tout montrer ?
Si les médias oublient parfois – ou feignent d’oublier – qu’aujourd’hui la télévision peut se regarder sur smartphone, certaines images leur rappellent périodiquement qu’elle peut aussi se faire avec ces appareils. Très peu de temps après la tuerie de Charlie, fut diffusée une séquence dans laquelle on voyait un des frères Kouachi exécuter à bout portant un policier, Ahmed Merabet. L’homme qui a pris les images était chez lui quand il a entendu des coups de feu. Instinctivement il a filmé la scène et, « paniqué », ayant besoin d’en parler à quelqu’un, il a mis son petit film sur Facebook avant de le retirer un quart d’heure après. C’était trop tard. Déjà les chaînes s’en étaient emparées et Le Point en ferait sa couverture, mettant en exergue la photographie par un cadre.
Les journalistes doivent être des gatekeepers
D’un point de vue éthique, on peut juger ces deux usages différemment. La première diffusion de la séquence est un symptôme de l’extension de la nouvelle concurrence régnant dans le monde de l’information d’aujourd’hui : non seulement les chaînes veulent avoir un scoop avant les autres, mais elles ne veulent pas être en reste devant la circulation des images prises par des amateurs sur les réseaux sociaux. Les propos d’Hervé Béroud, le directeur de la rédaction de BFMTV, sont très symptomatiques à cet égard : « Lorsque je suis rentré chez moi, mercredi, vers 23 heures, ma fille de 14 ans s’est étonnée de ne pas avoir vu les images de l’exécution du policier sur mon antenne, alors qu’elle avait tout vu sur le Net. »
De cette concurrence de fait, il tire la conclusion que les chaînes ne doivent pas s’interdire de montrer de telles images, oubliant au passage que ce qui différencie les journalistes des amateurs, c’est qu’ils doivent être des
gatekeepers, des gardiens de l’information et juger de ce qui peut, doit et ne doit pas passer sur leur média.
Pour juger de l’opportunité de diffuser de telles images, il faut toujours faire la balance entre le droit à l’information et l’atteinte à la dignité humaine. Du premier point de vue, la photo de cette exécution sommaire apporte certes des informations, notamment sur le déroulement des événements et sur la froide détermination du tueur. En revanche, à partir du moment où on la repasse en boucle, elle n’informe plus du tout. Pire, elle banalise l’atrocité du geste. On a déjà assisté à ce phénomène pour l’attentat des Twins Towers. À force d’en diffuser des images, de les faire figurer dans des génériques, dans des rétrospectives, etc., on a gommé l’horreur dont elles étaient pourtant grosses.
La publication dans le Point, après coup, dans un cadre placé au milieu de la couverture, pose un autre problème. Cet encadrement répond à la recherche de l’image qui fera le tour du monde, de l’image qui marquera le plus haut degré d’émotion de cet événement. Elle est l’équivalent actuel de cet instant prégnant, théorisé au XVIIIe siècle par Lessing, cet instant fixé par une sculpture pour provoquer chez son spectateur l’émotion la plus intense. Comme le notait l’écrivain, cet instant devait résister au temps car « ces œuvres sont faites pour être non seulement vues, mais contemplées longuement et souvent »
. C’est exactement dans cet esprit que le Point a cherché cette image qui entrerait dans l’histoire avec l’émotion maximum. Malheureusement, une image comme celle-ci est aussi, est d’abord, autre chose qu’une bonne information : l’instant précis de la mort d’un homme abattu comme un chien. Roland Barthes considérait qu’on pouvait regarder une photographie en adoptant trois points de vue différents : celui du photographe, celui du spectateur et celui de ce qu’il appelait le spectrum, le sujet photographié, ce spectre qui revient quand déjà la personne représentée a disparu.
Ceux qui diffusent les images – journaux, chaînes – ne se préoccupent guère que des deux premiers. Le photographe prend des photos au nom du droit d’informer le spectateur. Et celui qui est dans l’image ? Le droit nous dit aussi que sa représentation ne doit pas être une atteinte à la dignité humaine. Après la catastrophe du téléphérique du Pic de Bure, le 1er juillet 1999, Paris-Match publia des photos des victimes au sol. Deux frères assignèrent Paris-Match en justice parce qu’ils jugeaient que la photo de leur frère mort était attentatoire à la vie privée et familiale, ainsi qu'à la dignité humaine. Et la juridiction civile considéra que « le traitement de la photographie aérienne litigieuse, qui ne représente pas une vue d'ensemble du lieu de l'accident, comme le prétend la défenderesse, mais une vue dont le cadrage et le grossissement sont étudiés pour attirer l'attention sur les corps déchiquetés des victimes, identifiés par un numéro aisément lisible, caractérise la recherche du sensationnel, en faisant fonctionner le ressort émotionnel face au spectacle de la mort ; que cette présentation délibérée ne répond pas à une nécessité informative »
.
Je ne sais pas quelle serait la décision du juge si des poursuites étaient engagées contre
le Point, mais nul doute que le magazine recherche lui aussi le ressort émotionnel face à la mort par l’encadrement de la photo au milieu de la couverture. Quant à la nécessité informative de cette image arrêtée, multi-diffusée par les médias, le moins que l’on puisse dire est qu’elle n’est pas évidente.
L’idée que l’image ment est devenu une doxa
Depuis la retransmission des événements survenus pendant la révolution roumaine en 1989 et l’affaire du faux charnier de Timisoara, la confiance des citoyens dans les médias s’est fortement érodée. L’idée que l’image ment est devenu une doxa. L’abondance d’images qui a accompagné ces événements tragiques a entraîné une nouvelle attitude qui n’est pas plus rassurante. Des internautes se sont mis à examiner avec minutie les détails des photos pour y déceler des contradictions avec ce qu’ils appellent la « version officielle ». Du changement de couleurs des rétroviseurs de la voiture des frères Kouachi en deux moments différents, ils concluent qu’il y a eu deux voitures sans savoir que deux rétroviseurs chromés changent de couleur en fonction de la lumière réfléchie. De deux mains rapprochées de Coulibaly au moment où il sort de l’Hyper Cacher, ils concluent qu’il était menotté…