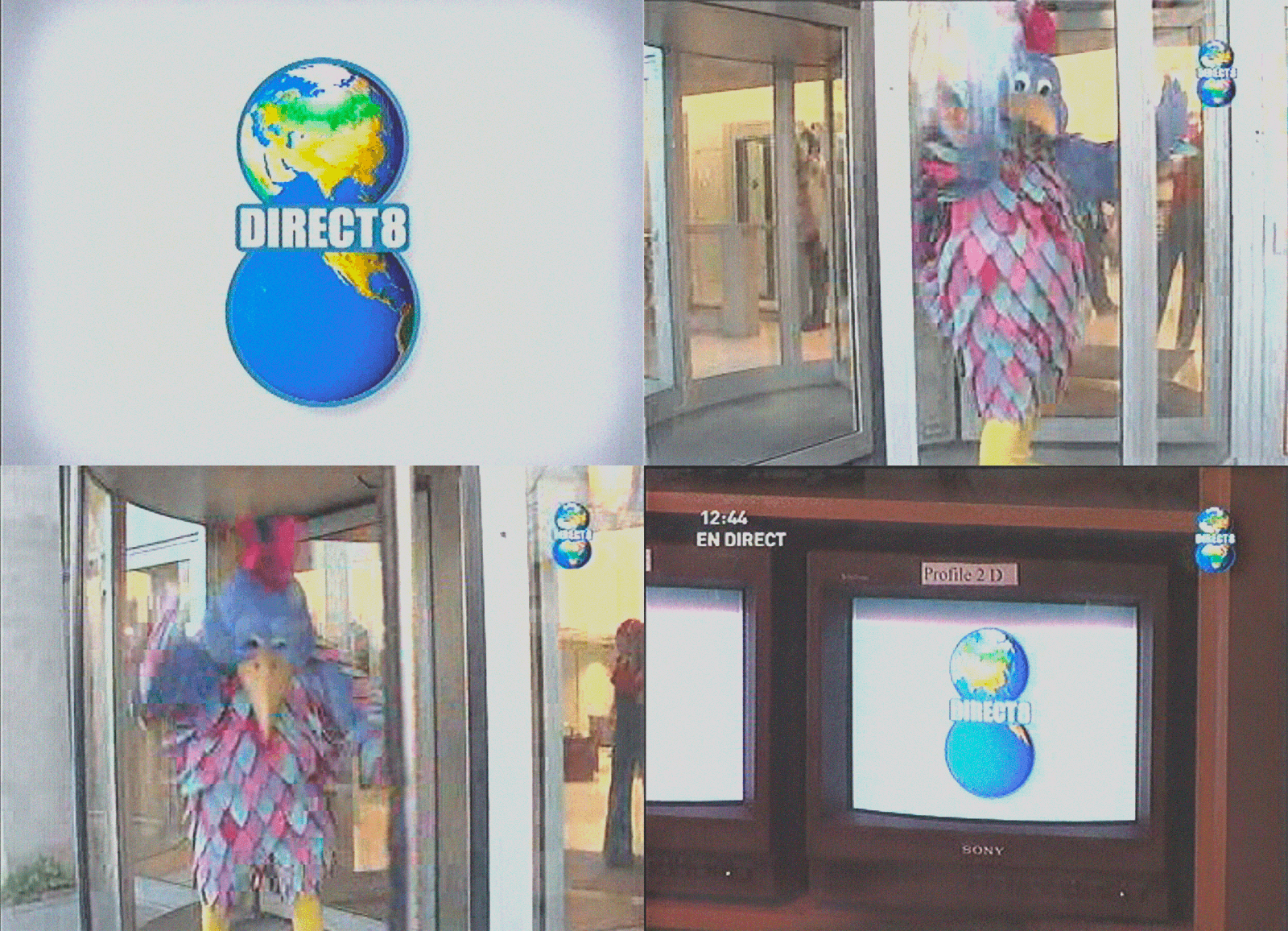Jean-Marie Charon, est un sociologue spécialisé dans l’étude des médias, rattaché au Centre d’étude des mouvements sociaux (EHESS). Il préside depuis 2001 Les Entretiens de l'information.
Vous avez récemment dénoncé dans un article sur L’Observatoire des médias le rapport du président Emmanuel Macron et de sa majorité parlementaire aux journalistes. Que leur reprochez-vous ?
Jean-Marie Charon : Nous avons l’impression d’un climat défavorable et d’une attitude de défiance au plus haut niveau de l’État à l’égard des médias et de la manière de travailler des journalistes. Cela se caractérise notamment par une forme de critiques répétées, ouvertes, officialisées. Lorsqu’Emmanuel Macron dit de la presse qu’elle « ne cherche plus la vérité », il peut difficilement être plus brutal. Rappelons que candidat, il invectivait déjà la presse de cette façon.
Au cours de ces dernières semaines, plusieurs journalistes ont été convoqués successivement par la DGSI, dont certains sont très connus, comme ceux du Monde. Ce n’est pas une nouveauté, mais l’accumulation d’une dizaine de convocations est frappante. De nombreuses initiatives prises récemment interfèrent dans le travail des journalistes. Début février, Mediapart a ainsi été visé par une perquisition.
Il y a deux ans, En Marche souhaitait créer un média d’opinion, au motif que le parti se considérait mal traité par les médias traditionnels. À peu près à la même époque, La France insoumise prenait la même initiative et lançait Le Média, alors que le parti se revendiquait d’une certaine modernité. Un tel désir représente une forme de retour en arrière.
Cette conception de l’articulation entre politique et information constitue une régression. Il existe une confusion, un mélange des genres entre journalisme et politique, qui apparaît dès la Révolution française et qui est très présent durant la IIIe République. Georges Clemenceau, Aristide Briand et Jean Jaurès étaient à la fois des hommes politiques de premier plan et des directeurs de journaux, voire des journalistes. Depuis les années 1980 et 1990, on avait toutefois l’impression d’être sorti de cette conception.
Il existe par ailleurs une tension en France autour de l’encadrement du travail journalistique, avec l’actualité chaude comme prétexte : la protection des personnes après les faits divers, l’interdiction de prendre des photos avec des personnes menottées, la lutte contre la propagation des fausses informations…
Jean-Marie Charon. Crédits : DR.
Vous faîtes ici référence à la loi contre « la manipulation de l’information », connue également sous le nom de loi anti-fake news… Vous parait-elle inadaptée ?
Jean-Marie Charon : Le premier bon réflexe serait de se demander ce qu’il existe dans l’arsenal juridique par rapport à ce problème et que l’on peut mobiliser. Dès qu’un problème apparaît, doit-on faire une loi ? Il existe déjà un article sur les fausses nouvelles dans la loi de 1881 [sur la liberté de la presse]. Lorsque j’avais été auditionné à ce sujet par l’ancienne ministre de la Culture, Françoise Nyssen, elle m’avait répondu que c’était un article difficile à utiliser, alors qu’il suffisait d’en modifier un peu les conditions d’utilisation.
L’autre problème c’est que le parquet ne poursuit pas au nom de la loi de 1881. Le ministère de la Justice peut changer cela : il suffit d’insister pour que dans les consignes données au procureur, l'on poursuive davantage les cas de fausses nouvelles par le biais de cette loi.
En outre, la mise en œuvre du projet paraît problématique. Tout d’abord, parce que le gouvernement a fait une loi pour les périodes électorales. Qu’est-ce qu’une période électorale sachant qu’une élection présidentielle se prépare souvent deux ans à l’avance ? Ensuite, parce que cette loi est surréaliste puisqu’elle demande aux juges de statuer sur une fausse nouvelle dans un délai très court. Si l’on prend pour exemple les accusations de 2017 autour d’un supposé compte bancaire d’Emmanuel Macron aux Bahamas, comment un juge pourrait-il définir en 24 heures si c’est vrai ? Durant les campagnes, les candidats s’envoient des arguments difficilement vérifiables. Le juge va-t-il indirectement rectifier la parole d’un candidat en condamnant un média qui a repris sa parole ? Cette loi paraît donc inadaptée au problème.
Les pools (terme qui désigne les journalistes autorisés couvrir un événement) ont été réduits, les bureaux des agences de presse (AFP, AP, Reuters) de l'Élysée délocalisés… Y-a-t-il une volonté de complexifier l’accès au pouvoir et d’accentuer le contrôle sur le travail des médias ?
Jean-Marie Charon : J’y vois une double dimension. La première, c’est la banalisation d’un discours de méfiance. Délocaliser les bureaux des agences de presse revient à dire : « Vous êtes comme les autres et on ne va pas vous traiter différemment parce que vous êtes de l’AFP, de Reuters ou d'AP. On vous remet un peu à votre place. » Récemment, Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, a ainsi déclaré que « les journalistes sont des justiciables comme les autres ».
On ne peut pas désigner ceux qui sont ou non de bons journalistes sur le seul critère de la carte de presse.
La seconde dimension, c’est l’encadrement et la volonté de définir encore davantage les règles du jeu et la façon dont les journalistes doivent travailler. Lors de son voyage au Mali en 2017, Emmanuel Macron avait décidé que seuls les journalistes spécialisés sur la question l’accompagneraient, et non les journalistes politiques, ce qui était le cas auparavant. Les journalistes avaient alors prétexté que ce n’était pas au président de la République de décider qui devait ou non l’accompagner.
Les propos de Sibeth Ndiaye font écho à ceux de Christophe Castaner qui, à propos de l’affaire Gaspard Glanz, avait affirmé : « Je pense que journaliste, c'est aussi avoir une carte de presse »…
Jean-Marie Charon : C’est un autre élément qui me frappe. Il s’agit soit d’une dégradation de la culture politique, soit d’une volonté de fragiliser les acteurs du paysage des médias. La loi de 1935 affirme que la profession n’est pas fermée : « Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l’exercice de sa profession [dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques et dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources]. » On ne peut donc pas désigner ceux qui sont ou non de bons journalistes sur le seul critère de la carte de presse.
« Il existe une zone grise autour de la profession de journaliste. »
Le problème est qu’aujourd’hui la notion de média a changé avec les réseaux sociaux, les blogs, etc. Il existe une zone grise autour de la profession. Avec des gens qui sont employés par des supports d’information qui n’ont pas le statut de médias, qui n’ont donc pas le statut de journalistes, mais font du journalisme. De la même manière, certains employeurs imposent le statut d’auto-entrepreneur à des personnes qui font du journalisme, ce qui les empêche d’obtenir la carte de presse. On a du mal à chiffrer cette zone grise, mais elle se situerait autour d’un tiers de la profession, si ce n’est plus.
Tout cela s’inscrit par ailleurs dans un contexte de fragilisation des modèles économiques des médias. Les rédactions ont des effectifs moins nombreux, donc certains sont amenés à travailler à la périphérie de la profession et cela concerne tous types de médias, publics ou privés.
Emmanuel Hoog a récemment remis un rapport au ministre de la Culture dans lequel il recommande la mise en place d’une instance d’autorégulation et de médiation de l’information. Pourquoi le gouvernement s’investit-il autant sur ce sujet ?
Jean-Marie Charon : Tout d’abord, je comprends qu’il existe un mouvement chez les éditeurs, les journalistes ou certaines associations qui vont dans le sens d’une création d’un conseil de presse. Même si je ne pense pas que ce soit la meilleure idée qui soit, je respecte l’intérêt des professionnels pour la chose.
Il existe une vieille tentation de penser que l’on va régler un certain nombre de problèmes au sein du milieu journalistique en mettant en place une autorité pour les gérer. C’est une idée qui revient fréquemment. Le CSA a essayé de prendre la balle au rebond à de multiples reprises, estimant être en mesure de le faire. Durant l’affaire d’Outreau, l’idée d’une telle instance avait émergé au sein d’une commission parlementaire. Plus récemment, la loi Bloche introduit un encadrement de dispositifs déontologiques. Ce qui m’étonne, ce sont les points de rapprochement à propos des médias entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Quand la mission Hoog a été lancée, j’ai été frappé par les propos du leader de La France insoumise qui apportait son soutien à ce qu’il décrivait comme « un tribunal de la presse ».
« La situation actuelle ressemble à une dérive autoritaire. »
Tout cela fait partie d’une stratégie d’intimidation : il souffle un vent mauvais sur la presse française actuellement. Quand vous regardez les signalements de David Dufresne
, une centaine d’entre eux concerne des journalistes malmenés par la police. On ne peut pas imaginer que la police ne soit pas plus vigilante à ce sujet. La situation actuelle ressemble à une dérive autoritaire. Les politiques jouent sur la défiance de l’opinion envers les médias, qui est de plus en plus visible. Lors du mouvement des « gilets jaunes », plusieurs journalistes ont été pris à partie, voire frappés.
Les politiciens jouent sur cette désaffection et surinvestissent dans la communication politique en se montrant virulents et en appelant leur soutien à s’attaquer aux médias. Marine Le Pen le fait, ce qui n’est pas surprenant car son père jouait déjà sur ce registre. Mais durant la campagne présidentielle, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon ont eu au recours à ces pratiques de manière tout aussi fréquente.
En quoi la relation du pouvoir actuel avec la presse se distingue-t-elle de celle qu’entretenait François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ou François Hollande ?
Jean-Marie Charon : Ce sont des styles différents. Sous François Mitterrand, il y avait un aspect « basse police » avec des écoutes téléphoniques. Sous Jacques Chirac, il y avait encore un contexte dans lequel le pouvoir politique pouvait marquer son désaccord avec certains éditorialistes et journaux, mais sans attaquer directement les médias. Ils ne les présentaient pas comme des ennemis de la vérité. C’était un tabou que les politiciens s’imposaient, alors qu’en privé ils étaient parfois critiques envers leur médiatisation. Ils se gardaient de le déclarer publiquement, car il existait une représentation partagée selon le rôle des journalistes compte parmi les piliers de la démocratie.
Des barrières sont tombées, notamment sous la présidence de Nicolas Sarkozy, qui était entre les embrassades et les insultes, parfois directes. Il avait commencé à avancer sur le terrain de la production de contenus en parallèle des médias. Avec Ségolène Royal, ils ont été les premiers à employer des sociétés de production audiovisuelle pour filment leur campagne électorale. Bien, sûr les grandes chaînes de télévision n’ont pas pris ces images, parce qu’elles désiraient une maîtrise, une plus grande liberté. Mais les chaînes d’information en continu, qui ont besoin de beaucoup d’images, en ont profité.
Les propos de Sibeth Ndiaye visent à banaliser cette idée selon laquelle il n’y a pas de raison de traiter de façon particulière les journalistes. Sauf qu’elle joue sur les mots : si un journaliste vole dans un supermarché, bien sûr que c’est un justiciable comme les autres — l’AFP a réalisé un fact checking sur le sujet. Mais tout un ensemble de lois indique le contraire, à commencer par la loi de 1881, ou celle de 1935 qui explicite que, pour un certain nombre de choses, les journalistes sont hors du droit commun, d’où les clauses de cession
et de conscience. Enfin, la Cour européenne des droits de l’homme a qualifié les journalistes « d'indispensables "chiens de garde" » et il existe une loi sur le secret des sources. Sibeth Ndiaye a donc tort : le journaliste dans l’exercice de son métier n’est pas un justiciable comme les autres. Et alors que l'on ne mettait pas en cause le journalisme comme pilier de la démocratie, de nombreux partis le font aujourd’hui.