Les 42 millions de foyers abonnés à Sony Entertainment Television attendaient le 22 avril 2012 avec impatience. Ce jour-là, la chaîne devait diffuser, pour la première fois à la télévision et en prime time, le film Dirty Picture dont elle avait acquis les droits pour 1,6 million $. Quatrième succès de l’année 2011 au box-office indien, Dirty Picture raconte la lente descente aux enfers de l’actrice Silk Smitha, sulfureuse et plantureuse icone du cinéma de l’Inde du Sud. À l’origine destiné à un public adulte, le film avait subi 56 coupures de la part du CBFC (Central Board of Film Certification) - dont 36 proposées volontairement par les producteurs - afin de recevoir le certificat U/A (tout public avec discrétion parentale) qui lui permettrait d’être diffusé à la télévision.
Bande annonce du film Dirty Picture
À l’heure dite, les téléspectateurs, dont l’appétit avait été aiguisé par plusieurs semaines de campagne promotionnelle intensive, ne trouvèrent sur leur écran qu’un message de la chaîne annonçant qu’elle regrettait l’annulation de la diffusion de
Dirty Picture. La veille au soir, le ministère de l’Information et de la Diffusion audiovisuelle avait fait savoir à la chaîne que la thématique adulte du film le rendait inadapté au
prime time, et ce quel que soit le certificat.
L’incident a provoqué une levée de boucliers au sein de la profession. En plus de compromettre gravement les perspectives de revenus de
Dirty Picture en matière de droits satellites, l’aspect arbitraire de la décision n’a pas manqué d’être dénoncé alors que le Bureau de certification avait accordé le certificat adéquat et que la Haute Cour de justice de Bombay avait également autorisé la diffusion aux horaires proposés. Sony Entertainment s’est abstenu de tout commentaire ou évaluation chiffrée du manque à gagner publicitaire.
La censure, qu’elle provienne des canaux officiels ou de la rue – en l’occurrence, le ministère aurait agi en raison de plaintes reçues de nombreux téléspectateurs – constitue toujours la grande inconnue de l’industrie cinématographique indienne. Elle crée souvent un climat d’incertitude qui ajoute au suspense du film, pour les téléspectateurs, un vrai suspense pour les producteurs et le réalisateur… sur les conditions de sa sortie.
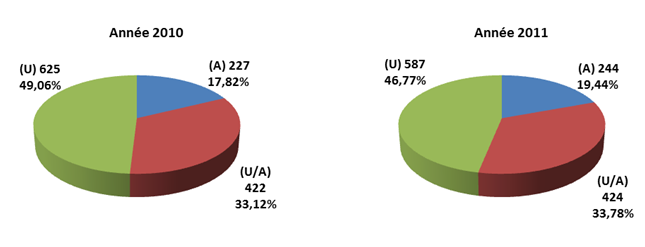



.jpg)



